




III.3.1. Utilisation et apprentissage de comportements réactifs
Dans cette première série d'expériences, nous avons
cherché à doter Khépéra de comportements purement
réactifs vis-à-vis des obstacles. Les commandes motrices sont
directement inférées des valeurs sensorielles.
Prenons l'exemple de l'évitement d'obstacle. Le but poursuivi est
de donner la capacité à Khépéra d'éviter
les obstacles et d'aller en ligne droite lorsqu'il est en espace libre.
Nous avons choisi d'utiliser pour cette expérience les 3 variables
Dir, Prox et Vrot. La description correspondante va donc être
une distribution de la forme :
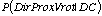 [3.5]
[3.5]
Le protocole expérimental adopté est constitué de 2
phases:
- Une phase d'apprentissage pendant laquelle Khépéra est
piloté par un opérateur à l'aide d'un joystick.
Durant cette phase les données expérimentales D (valeurs
des variables sensorielles Dir et Prox et de la commande
motrice Vrot) sont enregistrées et les paramètres,
permettant de stocker P(Dir Prox Vrot | D C) en machine,
sont identifiés
- Une phase de restitution où Khépéra évite
les obstacles tout seul. Les calculs formels probabilistes sont alors utilisés
pour calculer à chaque instant la commande motrice Vrot à
envoyer aux roues en fonction des données sensorielles Dir
et Prox provenant des capteurs de proximité.
La description P(Dir Prox Vrot | D C) obtenue lors de l'apprentissage,
dépend évidemment des expériences D, mais aussi, et
d'une certaine manière surtout, des connaissances préalables
C.
Les connaissances préalables C données par le concepteur peuvent
être regroupées en 4 catégories de natures différentes
:
- les connaissances préalables structurelles sont définies
par l'ensemble des variables {V1,...,Vn} sur lesquelles
la distribution de probabilité va être construites. Pour notre
exemple, comme il a déjà été dit, 3 variables
ont été choisies : Dir, Prox et Vrot.
- Les connaissances préalables de dépendances sont
données par une structure de dépendance[11] permettant de décomposer de manière
unique une description comme un produit de distributions plus simples.
Ces simplifications essentielles sont fondées sur des considérations
d'indépendances conditionnelles entre variables. Pour l'exemple
qui nous occupe, les règles des probabilités donnent :
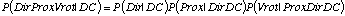 [3.6]
[3.6]
- Nous pensons a priori qu'il n'existe pas de corrélations particulières
entre la direction dans laquelle on observe un obstacle et la distance
à cet obstacle. Nous traduisons cette connaissance pour notre robot
en lui disant que Prox est indépendante de Dir conditionnellement
à D et C.
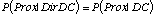 [3.7]
[3.7]
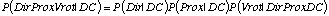 [3.8]
[3.8]
- Les connaissances a priori donnent des valeurs initiales (avant
apprentissage) aux distributions ou explicitent une méthode pour
les calculer à partir d'autres distributions connues. Une connaissance
a priori peut aussi, par exemple, exprimer qu'une distribution est supposée
ne pas évoluer en fonction des données.
- Nous n'avons aucune raison de penser que le robot sera amené
à rencontrer les obstacles suivant une direction privilégiée
ou à une distance particulière. Nous adoptons donc comme
a priori que toutes les couples (Dir, Prox) sont équiprobables,
ce qui se traduit par :
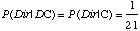 [3.9]
[3.9]
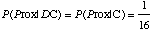 [3.10]
[3.10]
- Enfin, les connaissances préalables d'observation, qui
se décomposent en la spécification d'une représentation
paramétrique et d'un processus d'apprentissage (identification des
paramètres) pour chacune des distributions de la structure de dépendances.
Une représentation paramétrique permet d'une part, de représenter
ces distributions en machine et d'autre part, d'identifier leurs paramètres
par apprentissage.
- Pour cette expérience, on a utilisé une loi de succession
de Laplace comme représentation paramétrique de :
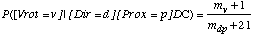 [3.11]
[3.11]
- Où :
- mdp est le nombre de fois où la situation sensorielle
Dir=d et Prox=p a été rencontrée pendant
l'apprentissage
- mv est le nombre de fois ou Vrot=v a été
observé pour la situation sensorielle précédente.
- 21 est le nombre de valeurs possibles pour Vrot.
- Pour un nombre important d'expériences, la loi de succession
de Laplace se rapproche d'un simple histogramme défini par mv/mdp.
Les termes correctifs 1 et 21 servent à traiter les cas où
le nombre d'expériences est faible. En particulier pour mv=mdp=0,
on trouve 1/21 soit la distribution uniforme.
Par le calcul formel, on peut alors, en phase de restitution commander
Khépéra en choisissant à chaque instant Vrot
suivant la distribution P(Vrot |Dir Prox D C).
La commande de Khépéra par cette méthode fonctionne
très bien. Après un temps d'apprentissage de quelques minutes,
(< 5 minutes) on obtient le comportement souhaité (voir figure
11). Le comportement obtenu s'avère être très "robuste"
au changement de position, de taille, de forme, de matière, de couleurs[12] et même de vitesse des obstacles,
ainsi qu'aux conditions d'éclairage de la scène.
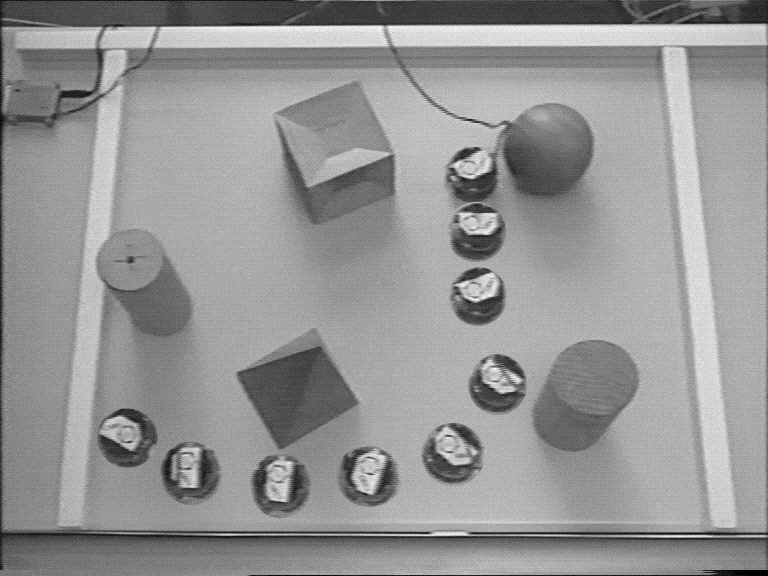
Figure 11 : comportement d'évitement d'obstacle
Avec la même méthode et les mêmes connaissances préalables,
en changeant l'apprentissage téléopéré au "joystick",
on a appris a Khépéra à suivre les murs et contours
(voir figure 12) et à poursuivre les obstacles mobiles.
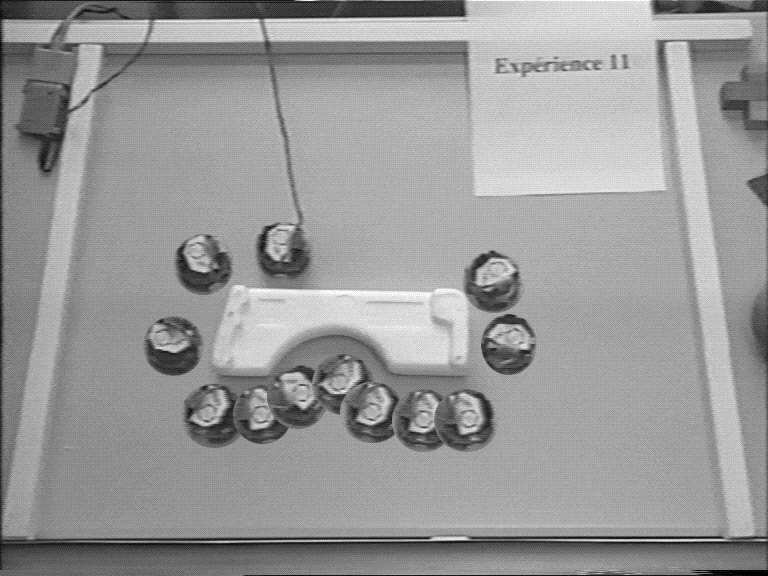
Figure 12 : comportement de suivi de contour
Avec la même méthode, sur la base des variables Vrot
et Lum nous avons appris à Khépéra un comportement
photophile représenté par la description P(Vrot Lum
| D' C').
[11]Une structure
de dépendance est une généralisation de la notion de
réseaux bayésiens due à J. Pearl [Pearl91].
[12]En fait, seul les obstacles
noirs et mats, que les proximètres ne voient pas du tout, posent
un problème.





[3.5]
[3.6]
[3.7]
[3.8]
[3.9]
[3.10]
[3.11]